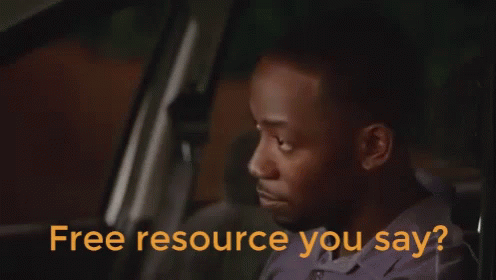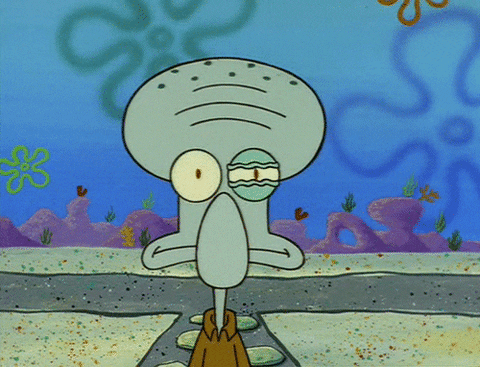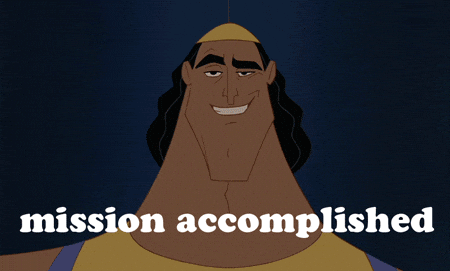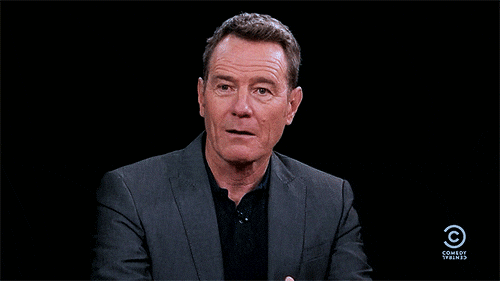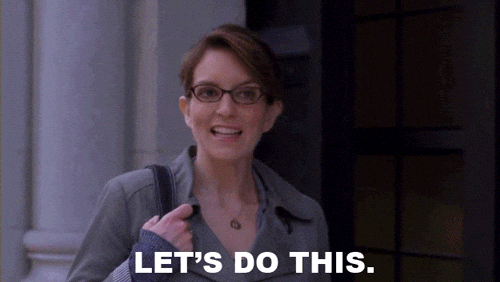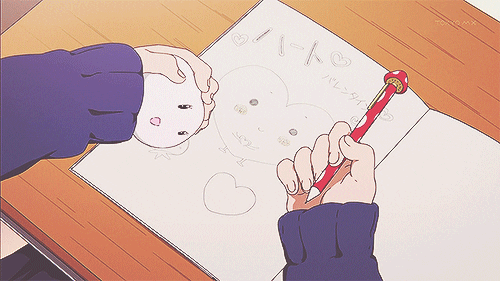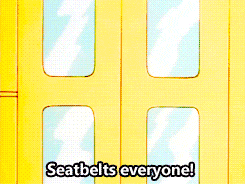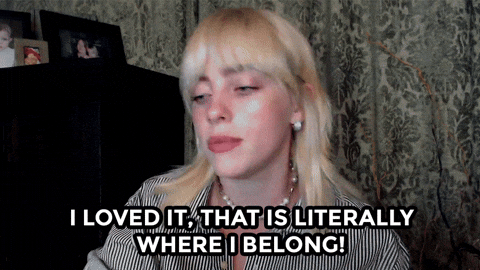Il y a quelques temps, on m’a interrogée sur mon parcours de lectrice (pour une opportunité incroyable, je vous en reparle bientôt), et j’ai pris conscience de quelque chose.
Mon amour des livres, je le dois aux endroits où l’on peut emprunter des livres.
Histoire de la petite Jeanne qui cherche partout où sont les livres gratuits
Je ne dis pas qu’on ne m’offrait jamais de bouquins, mais l’immense majorité de tout ce que j’ai lu jusqu’à l’âge adulte, je l’ai emprunté dans un CDI, une bibliothèque d’école, ou une médiathèque. Il y avait des livres à la maison, et on m’en a lu quand j’étais petite, mais dans une famille avec 3 enfants et deux salaires corrects mais pas mirobolants, acheter des livres était un luxe. Je mettais des livres sur mes listes pour le Père Noël, pour mon anniversaire, je traînais dans les rayons livres des supermarchés quand nous allions faire les courses, mais nous ne fréquentions pas les librairies indépendantes de notre ville, et quasiment pas les grandes surfaces culturelles.
Par contre, en maternelle et en primaire, la visite hebdomadaire dans la petite BCD de mon école était le temps fort de ma semaine. Je me souviens demander très souvent aux assistantes pédagogiques qui s’en occupaient combien de livres je pouvais emprunter à chaque fois, et je savais que la réponse était “Un seul, Jeanne, je te l’ai déjà dit”. J’avais toujours un “livre de la BCD” dans mon sac. A l’arrivée au collège, le CDI est devenu un refuge pour l’intello grosse harcelée que j’étais, et là, je pouvais en emprunter plusieurs à la fois. Jusqu’en terminale, les CDI ont fait office à la fois de cocon, de fenêtre et de source inépuisable de lectures dans ma vie.
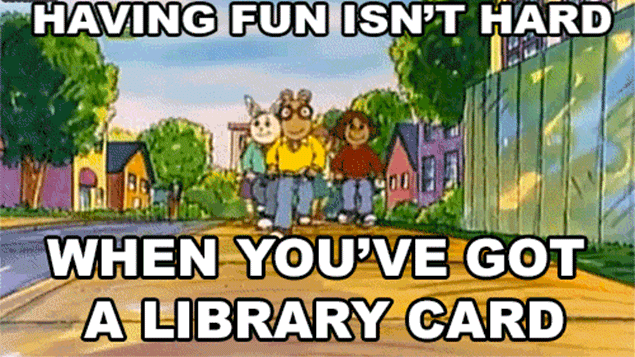 |
| Moi et tous les cool kids du Collège Boileau |
Aujourd’hui, cependant, j’aimerais parler de mon rapport aux médiathèques et la façon dont j’ai recommencé à m’y rendre régulièrement cette année.
Parce qu’en plus des bibliothèques présentes dans les établissements scolaires que j’ai fréquentés, nous allions à la médiathèque municipale. En primaire, je me rappelle très bien le jour où avec mon père, nous sommes allés me faire ma première carte de bibliothèque. Il me semble qu’avant le collège, nous y allions régulièrement avec l’un de mes parents et mes soeurs, peut-être une à deux fois par trimestre, pour faire le plein de livres. Bien sûr, nous étions toujours en retard pour les rendre. Et puis au collège, j’ai commencé à aller seule dans ma bibliothèque de quartier, et je revenais chez moi le sac à dos plein à craquer. Vingt documents empruntables en une fois. Vingt.
 |
| Vidéo souvenir de moi à 12 ans remplissant mon faux Eastpak de romans. |
Ensuite, les études de lettres et la fréquentation des bibliothèques universitaires m’ont éloignée des médiathèques. J’ai fini libraire, c’est à dire vendeuse en magasin de livres, et le flux constant de nouveautés a suffi à assouvir ma soif de lectures (pour créer une pile à lire si gigantesque que c’est devenu mon pseudo sur l’Internet, donc autant dire que je ne manquerai plus de livres jusqu’à la fin de ma vie).
Mon retour en médiathèque - ou comment retrouver le plaisir de flâner
J’ai la chance d’avoir dans mon entourage amical et professionnel des médiathécaires, mais aussi des gens qui fréquentent leurs médiathèques. Cela fait quelques années que je les écoute me raconter les conférences qu’elles organisent, des découvertes qu’elles y font, des moments qu’elles y passent à travailler ou prendre un café.
Depuis quelques temps je cherchais dans Roubaix un endroit aussi chouette que la librairie-salon de thé où je travaille pour aller bosser sur ce blog ou sur d’autres projets quand je raccroche ma casquette de libraire. Le fait est qu’à une distance raisonnable de mon domicile, à part mon lieu de travail, je n’avais pas beaucoup d’options, et qui a envie d’aller sur son lieu de travail lorsqu’iel ne travaille pas? Pas moi.
Et puis je me suis souvenue de notre médiathèque, baptisée La Grand Plage, que je n’ai pas beaucoup fréquentée depuis que je vis à Roubaix. Depuis le printemps, je vais de temps en temps m’y poser avec mon ordinateur pour écrire, répondre à mes mails, avancer dans des projets.
Bien sûr, je m’y promène aussi. Sur les 4 niveaux accessibles au public, je redécouvre un plaisir que j’ai perdu depuis que je suis libraire : celui de flâner parmi les rayonnages, et se laisser surprendre par un titre, un dos de couverture, une sélection. De ne plus être à guetter les nouveautés et à se dépêcher de finir tel livre avant qu’il sorte pour pouvoir le conseiller à des clients, mais de seulement se laisser porter par son instinct et ses envies du moment, soudaines et inattendues.
 |
| Vidéo souvenir de moi la semaine dernière remplissant mon tote bag Combo de DVD. |
Depuis, j’y passe deux fois par mois, et je m’éclate. Je lis des choses dont je n’ai jamais entendu parler, je regarde plus de films, je me remets même au piano grâce au super rayon partitions.
J’aimerais vous encourager, si vous les avez un peu laissées tomber, à retourner fréquenter vos médiathèques. Il y a plein de bonnes raisons de le faire.
Pourquoi fréquenter sa médiathèque?
- C’est gratuit. Dans beaucoup de cas, en tous cas. Il y a encore des médiathèques qui font payer un abonnement (ce que je trouve aberrant, les usagèr·e·s paient déjà les médiathèques avec leurs impôts mais soit). Je répète pour celleux dans le fond : ça ne coûte rien. Parfois, il faut s’acquitter d’un petit montant pour avoir le droit d’emprunter certains documents - à Roubaix, pour pouvoir emprunter autre chose que des livres, c’est le cas, mais ça ne coûte que 17€ pour toute l’année. AUCUN autre abonnement que vous avez actuellement ne peut vous permettre d’accéder à des milliers de livres, CDs, DVDs, revues et même parfois des jeux vidéos, des jeux de société, des outils, des instruments de musique, des déguisements… pour quasiment RIEN.
- C’est accessible à toustes. Peu importe vos revenus, votre statut, la langue que vous parlez, votre âge, votre genre, vous avez toustes le droit d’aller à la médiathèque et d’y passer un chouette moment.
- Vous sortez des algorithmes. A l’heure où la culture se consomme en “bulles”, où on a l’impression de regarder les mêmes séries ou de lire les mêmes livres que tout le monde, aller à la médiathèque et vous laisser surprendre dans un rayon où vous flânez par un titre dont vous n’avez jamais entendu parler, ça rafraîchit l’esprit et titille la curiosité!
- Il s’y passe des choses. GRATUITES elles aussi. Des ateliers, des conférences, des moments ludiques, des lectures, des spectacles, des rencontres, des clubs de lecture/de tricot/de mécanique/d’écologie/(…), des expositions, des cours de langues ou d’informatique… La liste est infinie! De quoi sortir de sa routine, rencontrer des gens ou apprendre quelque chose!
- C’est un troisième lieu. Un lieu qui n’est ni la maison, ni le lieu de travail, où l’on peut rencontrer des gens, s’instruire, se reposer, se créer des habitudes. Comme le café dans Friends, vous voyez? D’ailleurs, pas mal de médiathèques, quand elles le peuvent, ont un véritable petit café ou salon de thé dans leurs locaux!
- Je le répète hein mais quand même, dans ce monde capitaliste aux fortes tendance fascisantes c’est fifou : C’EST SOUVENT GRATUIT!
Comment soutenir ma médiathèque?
Sachez qu’une bibliothèque ou une médiathèque, ce n’est pas un service obligatoire de votre mairie. Tout comme un musée ou une patinoire, si personne ne la fréquente et qu’elle finit par coûter trop d’argent, elle peut fermer. À l’heure où le service public se fait étrangler de tous les côtés, les médiathèques peuvent finir en première ligne des sacrifices faits à la gloire de la rentabilité. Il n’y a qu’à voir ce qui se passe aux Etats-Unis pour se rendre compte que ces espaces accessibles, gratuits, où l’on peut faire communauté ne plaisent pas à nos ennemis fachos-capitalistes-milliardaires-patriarcaux. Alors voici quelques petites actions que vous pouvez faire pour aider votre médiathèque locale:
- Créez votre carte de médiathèque. Même si vous n’y allez que deux fois par an. Même si vous n’y allez pas. Le nombre de personnes inscrites à la médiathèque permet de sortir des statistiques de “rentabilité” du lieu, et donc de justifier son existence. Et n’oubliez pas de la renouveler tous les ans. Ça prend 5 minutes et il ne faut amener qu’une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
- Utilisez votre carte de médiathèque. En tant que libraire j’y emprunte peu de livres, mais je dévore facile une dizaine de films par mois. Il n’y a pas d’enjeu. Même si vous empruntez trop, et que vous n’avez pas le temps de tout lire, ce n’est pas grave! Voyez ça comme du shopping gratuit! C’est quand même incroyable!
- Intéressez-vous à la programmation de votre médiathèque. Prenez le programme ou consultez-le en ligne, et n’hésitez pas à relayer autour de vous les événements que votre cercle de proches pourrait apprécier. Si vous travaillez dans un endroit où vous accueillez du public (un commerce, un cabinet avec une salle d’attente…), demandez quelques flyers ou affiches à la médiathèque et affichez-les. Participez activement à faire connaître votre médiathèque locale comme bien plus qu’un endroit où emprunter des livres.
- Utilisez les espaces de votre médiathèque. Allez-y pour répondre à vos mails, pour réviser vos examens, pour faire votre to-do list du mois, pour dessiner, pour rédiger vos cartes de vœux, pour écrire votre roman, pour mettre à jour votre journal intime. Occupez les espaces mis à disposition, pour justifier de leur existence mais aussi pour inciter d’autres à le faire.
- Soyez bénévole dans votre médiathèque. Si vous disposez de temps et que vous en avez les capacités, proposez quelques heures par mois à soutenir votre médiathèque locale. Il y a des réseaux entiers de bibliothèques qui fonctionnent grâce aux bénévoles, et plus vous êtes nombreux·ses, plus ça peut fonctionner!
- Soutenez publiquement votre médiathèque, parlez-en à vos élu·e·s quand vous les croisez, laissez des avis sur google, commentez leurs posts sur les réseaux sociaux… Plus on voit nos proches s’enthousiasmer pour un endroit, plus on a envie d’y aller!
On a trop peu d’espaces où l’on peut aller, s’installer, discuter, se former, lire, jouer à la console, échanger, discuter… sans avoir à payer, à rentabiliser. Les médiathèques sont un acquis social qu’on peut nous enlever, et c’est un acte militant de les fréquenter.
Et, je vous ai dit que c’était très très souvent gratuit?
J’aimerais beaucoup que dans les commentaires, vous partagiez vos souvenirs de bibliothèque, vos coups de cœurs pour des médiathèques près de chez vous, les meilleures découvertes que vous avez faites dans votre médiathèque… Et si vous avez d’autres pistes pour les soutenir, allez-y, je mettrai mon article à jour!